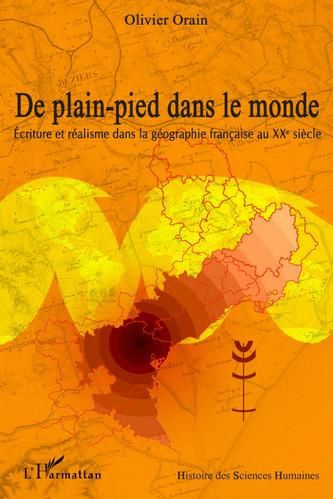Depuis presque quinze ans, la quasi totalité de mon travail de recherche a une orientation épistémologique : réfléchir à la fabrique du savoir et au statut de la connaissance vis à vis du “ réel ” constitue l’essentiel de mon activité intellectuelle. Avant même de faire de la recherche, ce type de questions avait déjà largement orienté mes intérêts philosophiques (en classes préparatoires) et mon inscription, lors de mon année de licence (1988-1989), dans le séminaire d’épistémologie de la géographie que dirigeait Philippe Pinchemel à l’université Paris I. Tout ceci a fait “ système ” lorsque, après avoir passé l’agrégation de géographie, je me suis inscrit au D.E.A. Analyse théorique et épistémologique en géographie (ATEG) en septembre 1991. Depuis cette date, mon identité disciplinaire d’épistémologue (de la géographie et des sciences humaines en général) n’a cessé de s’approfondir. Elle a valeur de “ spécialité ”, même si elle est plus que cela : état d’esprit ? posture ? habitus ?
Immédiatement après avoir suivi la formation du DEA ATEG en 1991-1992, je me suis inscrit en thèse sous la direction de Marie-Claire Robic. Le sujet déposé en octobre 1992 — résumant les orientations formulées dans mon mémoire de DEA — fut intitulé Référent littéraire et littérarité dans la géographie française au xxe siècle. Contribution à l’étude des rhétoriques du texte géographique. Qu’il s’agisse de géographie russe ou française, il avait toujours été dans mes intentions d’exploiter dans mon travail les outils herméneutiques de la critique littéraire dite “ structuraliste ” (ou poétique, si l’on reprend la terminologie de Gérard Genette). Ayant dû renoncer après les classes préparatoires à un cursus multidisciplinaire (même restreint à la troïka géographie/histoire/lettres modernes), toute ma trajectoire ultérieure a été sous-tendue par le désir de renouer le plus pleinement possible avec une certaine polyphonie disciplinaire — réinscrite dans un projet de recherche aussi cohérent que possible. Accomplir cela dans un travail de thèse était on ne peut plus séduisant ; encore fallait-il clarifier les contours du projet...
En 1992, ma problématique partait d’interrogations socio-biographiques : depuis un siècle et dans leur très grande majorité, les géographes français ont été formés dans une matrice “ littéraire ” ou ressortissant pour le moins aux “ humanités ” ; même si, depuis la formation de l’école classique française, ils n’ont eu de cesse de se démarquer (par des moyens divers) de la dite matrice, pouvait-on faire une sorte d’archéologie de cette strate “ primitive ”, en interrogeant notamment les façons d’écrire des géographes ? Et que dire de la contradiction (réelle ou supposée) entre les aspirations à la scientificité et les contraintes du “ bien écrire ” ? Je souhaitais à l’époque reconstruire une histoire des géographes français à l’aune de leur attitude vis à vis du référent littéraire et de ce que l’on pourrait appeler, faute de mieux, une “ écriture littéraire ”. Avec le recul, ce projet initial me paraît par trop périphérique par rapport à l’histoire de la discipline. Néanmoins, je persiste à penser qu’il y avait quelque chose d’heuristique à poser l’écriture littéraire comme problème posé à la géographie dans son devenir.
Mes premières années de thèse ont été marquées de fait par une mise entre parenthèses : à ma sortie de l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud en juin 1992, j’ai été recruté sur un poste de “ chargé de recherches documentaires ”, statut associant enseignement en université (à Paris I dans mon cas) et travail dans un organisme de documentation (en l’occurrence le Comité des travaux historiques et scientifiques [CTHS]). En théorie, le CRD est sensé pouvoir mener des recherches “ en relation avec son travail de thèse ” au sein de l’organisme d’accueil. Dans mon cas, il n’en a rien été : mes quinze heures hebdomadaires ont été considérées comme des “ moyens ” supplémentaires mis au service du dispositif éditorial. Pendant les deux années que j’ai passées au CTHS (1992-1993 et 1995-1996), j’ai donc été affecté à la préparation d’ouvrages (sur les sujets les plus divers). Lors de ma deuxième année de thèse, en 1995-1996, de très sérieux problèmes de santé ont contrarié l’ensemble de mon travail.
Entre 1993 et 1995, j’ai passé deux années à l’étranger au titre du service national de la coopération. Nommé enseignant-animateur culturel à l’Alliance française de Bahrein, avec des horaires très lourds (25 heures d’enseignement par semaine, auxquelles s’ajoutaient les heures de permanence et l’animation “ culturelle ”), j’ai été contraint de suspendre mon inscription en thèse pour toute la durée de ce séjour. Malgré tout, ces deux ans m’ont été extrêmement profitables. J’ai reçu la première année une véritable formation pédagogique. J’ai abondamment enseigné la civilisation et la littérature françaises à des publics composites et pas forcément acquis. Et que dire de l’expérience humaine accumulée, de la découverte de l’autre sous diverses formes...
De surcroît, lors de ma deuxième année dans le Golfe persique, j’ai pu répondre à une “ commande ” indirecte qui m’avait été faite par Roger Brunet. Ayant lu mon Rapport de stage en Russie, celui-ci avait suggéré d’en tirer pour l’Espace géographique un article susceptible d’être publié. Durant les mois de janvier à juin 1995, je me suis employé à relever le défi, avec l’aide précieuse de mon équipe parisienne. Tel qu’“ achevé ” en mai-juin 1995, l’article “ La géographie russe (1845-1917) à l’ombre et à la lumière de l’historiographie soviétique ” approchait les 96 000 caractères. Sa publication dans l’Espace géographique a amené le directeur de la revue à couper dans l’appareil démonstratif afin de limiter le dépassement des normes éditoriales. Quoi qu’il en soit, cette première publication à l’automne 1996 amplifiait et redonnait un sens à mes investigations de l’hiver 1992.
Le texte publié souligne l’importance considérable du genre “ histoire de la géographie ” dans 70 ans de production soviétique et la finalité essentiellement auto-justificative qui l’animait. Il s’agissait d’inculquer aux étudiants une “ vulgate ” stéréotypée confortant une certaine représentation des figures tutélaires et des thématiques de la discipline. Par contraste, les “ vrais ” problèmes que posait l’institutionnalisation de la géographie dans la Russie tsariste puis soviétique ne peuvent se lire qu’en creux. Au demeurant, les travaux spécialisés publiés depuis 1992 n’ont guère fait progresser le questionnaire. La question de la soviétisation de la géographie reste une inconnue, de même qu’il est difficile de préciser comment le paradigme du landchaftoviédiéniïé s’est imposé, dans une optique au demeurant exclusivement naturaliste. Je n’ai plus retravaillé sur l’histoire de la géographie russe depuis cette époque.
En définitive, ces années de mise entre parenthèses ont été des années de maturation silencieuse, grâce auxquelles j’ai pu (re)prendre ma thèse avec un autre regard et un peu de recul. L’enseignement, un travail éditorial au CTHS, puis le dépaysement et des difficultés de toutes natures, le retour, une “ longue maladie ” : tout ceci a contribué à infléchir ma recherche, qui s’est ressentie des expériences accumulées. La réflexion épistémologique demande peut-être ce suspens pour s’accomplir, c’est-à-dire pour n’être pas que manipulation de protocoles de recherche, pour donner à celui qui l’entreprend un sentiment de faire peut-être un peu sens (au moins pour soi).
En septembre 1996, alors que s’achevaient mon premier traitement médical et mon statut de chargé de recherches documentaires, j’ai débuté dans un nouveau poste de PRAG à l’université de Toulouse le Mirail. Malgré sa lourdeur, cet emploi m’a apporté bien des enrichissements. Mes collègues m’ont, dans leur très large majorité, traité comme un pair ; de sorte que, très vite, j’ai pu devenir maître de ce que je faisais, au lieu d’être confiné dans des tâches supplétives. Dès la première année, on m’a confié un cours semestriel sur “ L’effondrement de la Russie ” grâce auquel j’ai pu, depuis lors, considérablement étoffer ma connaissance de la Russie contemporaine et en faire bénéficier plusieurs promotions d’étudiants. Mais l’expérience capitale a débuté l’année suivante. Un module de licence intitulé “ Organisation de l’espace ”, dans lequel j’étais chargé de TD la première année, s’est vidé de presque tout son personnel à la rentrée 1997. Ayant passé une bonne partie de ma première année toulousaine à donner du sens à cette expression pour ma propre gouverne, je me suis proposé pour reprendre en main le module. Celui-ci avait beau être la seule U.V. généraliste de licence pour géographes, personne ne voulait plus en assurer la responsabilité, car il avait très mauvaise presse auprès des étudiants. Faute de concurrence, la direction de l’époque m’a confié la responsabilité de 32 heures de cours magistraux et de trois groupes de TD, de sorte que pendant trois ans j’ai toujours assuré plus de la moitié de mon volumineux service dans ce seul module.
Cette expérience a été capitale à plus d’un titre : loin d’être un simple module d’enseignement, “ Organisation de l’espace ” a été un lieu de recherche et d’auto-formation, un laboratoire pédagogique, parfois aussi une sorte de porte-flambeau. Ce module n’a jamais cessé d’être une expérience collective, jouant sur les complémentarités de “ sensibilités ” géographiques différentes, unies par le souci de faire réfléchir les étudiants. Si j’en crois les témoignages qui me sont parvenus, il semblerait qu’il ait été une expérience marquante (en positif ou en négatif) pour les promotions successives d’étudiants qui l’ont suivi avec plus ou moins d’assiduité. Il a pris très vite une tournure épistémologique marquée et a revendiqué en partage la formation critique (plutôt que positive) des étudiants en géographie du Mirail. Cela les a beaucoup déconcertés, d’autant plus que nous avons largement configuré la discipline au regard de champs extra-géographiques (épistémologie anglo-saxonne, économie spatiale, sociologie, anthropologie de l’espace, etc.) qui leur étaient presque toujours inconnus. En revanche, la légitimité pédagogique de ce module n’est plus remise en cause à ma connaissance.
Au sein de cet enseignement, mon interrogation principale a toujours été de clarifier ce que l’expression “ organisation de l’espace ” implique et peut recouvrir pour la discipline géographie. Aidé par les travaux de Marie-Claire Robic sur l’histoire de cette expression (Robic, 1982, 1995), j’ai été amené à faire des recherches sur les acceptions qui lui ont été assignées dans les années 1970-1980 (au détriment du sens d’“ aménagement du territoire ” dominant dans les années soixante). Pour ce faire, j’ai dépouillé une bonne partie du corpus de la géographie “ théorique et quantitative ” disponible en langue française (mais non exclusivement), ainsi que les précurseurs (de J. H. von Thünen à E. Ullman et J. Gottmann) et les détracteurs, en mettant l’accent sur la dimension spatialiste des théories plus que sur les problèmes de formulation mathématique. Parallèlement, j’ai essayé de faire retour sur les prises de position épistémologiques véhiculées par ce qu’on a appelé la “ nouvelle géographie ” et de pluraliser pour les étudiants la réflexion sur l’activité scientifique : non seulement ce qui peut la démarquer des autres activités humaines, mais aussi plus largement en les amenant à réfléchir sur la fabrique de la science (géographique en particulier) et sur les activités susceptibles de structurer une communauté disciplinaire.
Significativement, ces recherches à visée pédagogique sont progressivement entrées en congruence avec mon travail de thèse, conférant à celui-ci un caractère plus large que ce que j’avais conçu auparavant. Au cours de l’été 1997, j’ai tout à la fois commencé à préparer mes cours pour le module “ Organisation de l’espace ” et préparé mon intervention au colloque de Sion (Suisse), Géographie(s) et langage(s) : interface, représentation, interdisciplinarité, à l’occasion duquel j’ai formulé pour la première fois les hypothèses principales et la méthodologie de mon travail de thèse.
Avant d’évoquer celui-ci, il faut encore évoquer une autre recherche, directement liée à ma pratique d’enseignant à l’université de Toulouse-le Mirail. Dès ma deuxième année au département de géographie, outre un enseignement d’épistémologie générale et un autre d’initiation à l’analyse spatiale, j’ai toujours beaucoup mis l’accent sur les démarches systémiques. Or, à l’automne 2001, Marie-Claire Robic a dirigé un cours d’agrégation pour le Centre national d’enseignement à distance (CNED), relatif à la question intitulée “ Déterminisme, possibilisme, approche systémique : les causalités en géographie ”. Ma partie, intitulée “ Démarches systémiques et géographie humaine ”, a été distribuée en janvier 2002. Il ne s’agit pas d’un travail de compilation ou de didactique systémiste, mais — au moins pour les parties II et III — d’une véritable recherche en épistémologie. Dans ce texte, j’essaie de montrer que l’affinité des géographes pour l’idée de “ système ”, justiciable de nombreuses formulations intuitives pré-systémiques (au travers des concepts de “ combinaison ”, d’“ interrelation ”, etc.), s’est manifestée de façon fort précoce : dès la fin des années 1960, et surtout au début des années 1970, les géographes s’emparent, à tout le moins du terme, de l’idée, voire de la théorie du système général. Alors qu’on brocarde souvent le retard de la profession par rapport aux modes intellectuelles, il n’en a rien été dans ce cas précis. J’essaie de montrer que le schème systémique est venu à point nommé pour redonner une légitimité scientifique au type d’objets épistémiques que la géographie affectionne : des artefacts complexes et hétérogènes, non réductibles à une unité organique, et manifestant une certaine pérennité dans le temps. Un certain nombre de travaux qui ont fait date sont présentés, à commencer par la thèse de Franck Auriac. En revanche, mon travail ne prenait pas en compte les efforts légèrement antérieurs des géographes physiciens pour repenser une géographie physique globale à travers le concept phare de “ géosystème ” et la reprise à frais nouveaux de la notion de paysage. J’ai travaillé sur ce champ à l’occasion de cours en 2001, puis tout récemment dans un nouveau texte pour le CNED, “ La géographie française face à la notion d’échelle. Une approche par les significations et les contenus épistémologiques ”. La question de la rénovation de la géographie physique dans les années 1950-1960 et du rôle de personnalités comme Jean Tricart, Charles-Pierre Péguy et Georges Bertrand est de celles qui m’intéressent de plus en plus. Depuis 2005, j’ai entrepris également des recherches assez systématiques sur ce que je considère comme le “ présystémisme ” de la géographie classique. Outre un cours construit sur cette base et un recueil de textes significatifs, déjà établis, j’entends rédiger dans les mois qui viennent un article pour un manuel collectif avec les matériaux et réflexions amassés.
Il me resterait à préciser que durant mes années d’enseignement, malgré le caractère fastidieux de mon service, j’ai mis à profit les programmes d’enseignement (parfois imposés) pour développer ma connaissance de divers champs (l’histoire de la transition soviétique, l’analyse spatiale, la géographie rurale, l’anthropologie de la “ qualité ” agricole, la sociologie américaine).
Pour des raisons diverses (service de la coopération, longue maladie), mais surtout du fait de ma charge de PRAG, je n’ai commencé à travailler à ma thèse qu’à l’été 1997. C’est à cette époque que j’ai formulé pour la première fois mes hypothèses principales et ma méthodologie. Mon premier titre de thèse a cessé alors d’être pertinent (si l’on excepte le sous-titre), puisque que mon propos n’était plus d’explorer la littérarité cachée de la géographie française. Mon projet s’est redéployé en envisageant plus globalement l’écriture des géographes (acte complexe de “ mise en texte ” et de précipitation de la pensée) comme une sorte de révélateur épistémologique. Il s’agissait d’examiner la littérature disciplinaire du xxe siècle à l’aune d’une interrogation sur le statut épistémique de la réalité dans les travaux de géographes. Je voulais montrer que deux postures se sont succédé dans le temps. L’une, que l’on peut qualifier de “ réaliste ” au sens plein du terme, est intimement liée aux conceptions de ce que l’on appelle communément l’“ école française de géographie ”. L’autre, pressentie par certains géographes au cours du siècle, n’a vraiment été affirmée que dans les années 1970, en réaction précisément contre la posture classique. À des titres divers, on peut la considérer comme “ constructiviste ”. Ces postures pesant sur l’ensemble des pratiques savantes de la géographie, il apparaissait nécessaire de les situer dans un cadre épistémologique plus large, ce pour quoi j’ai eu recours à la théorie des paradigmes et révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Considérant qu’une période de “ science normale ” s’était ouverte au début du siècle avec l’installation des élèves de P. Vidal de la Blache dans les principales chaires universitaires de France, il s’est agi d’interroger ce qui constituait l’ossature du paradigme et les mécanismes présidant à sa reproduction. Dans le même esprit, les remises en cause des années 1970 se laissent aisément interpréter comme “ révolution scientifique ”.
Le caractère souvent implicite ou peu théorisé des positions épistémologiques en géographie a encouragé un recours abondant à des formes d’interprétation appuyées sur la critique littéraire (notamment sur les travaux de Gérard Genette, de Michel Charles et de Philippe Hamon) : travail sur les figures de rhétorique, l’énonciation, les formes d’ordonnancement du discours, l’intertextualité, etc. Mes premières investigations (en 1997-1999) ont essentiellement porté sur la géographie dite “ classique ” ou “ postvidalienne ”. C’est à cette époque qu’un examen de rares textes théoriques et de plusieurs corpus empiriques (thèses des élèves de Vidal, Géographie universelleAnnales de géographie) m’a amené à échafauder le schème du réalisme de la géographie (post)vidalienne. À l’occasion de plusieurs colloques (Sion, Poitiers, Cerisy, Rennes), j’ai eu l’opportunité de présenter mes analyses devant des publics divers. Je n’ai en revanche pas eu alors le temps d’approfondir mes réflexions sur des textes plus contemporains. C’est en 1999-2000 que j’ai entrepris un travail de dépouillement systématique des textes “ révolutionnaires ” des années 1970, conjointement à un approfondissement de la théorie kuhnienne (et des critiques qu’elle a suscitées). C’est par l’examen attentif de la littérature contestataire constituée en “ nouvelle géographie ” que s’est trouvée confirmée de façon éclatante l’hypothèse que le réalisme traditionnel était un verrou (un tabou ?) qu’un aggiornamento de la discipline impliquait de faire sauter. La critique nominaliste est un élément essentiel du réquisitoire des années 1972-1986, qui n’avait jusque là guère été pris en compte dans les examens rétrospectifs.
Au printemps 2001, la section Espaces, Territoires, Sociétés du CNRS m’a donné la possibilité d’être détaché pour deux ans sur un poste de chargé de recherches. Au 1er septembre 2001, j’ai donc quitté mon poste de PRAG et suis devenu chercheur à temps plein au sein de l’équipe Épistémologie et histoire de la géographie (UMR 8504 Géographie-cités), avec pour contrat explicite d’achever ma thèse de doctorat durant cette période de détachement. De surcroît, j’ai obtenu au printemps 2003 une prolongation d’un an. Cela est venu en quelque sorte compenser le temps perdu dans des problèmes de santé, en 2001 et en février-mars 2003.
À partir de 2001, mon travail sur la théorie kuhnienne m’a amené à de nouveaux développements sur le problème des signes avant-coureurs qui précèdent une phase de crise paradigmatique, ce que T. Kuhn appelle une “ anomalie ”. Il s’agissait de se demander si ce vocable avait du sens en géographie, et si l’on pouvait trouver des indices de quelque chose d’équivalent dans la production des années 1960. Par ailleurs, un examen des critiques anglo-saxonnes de la théorie de Kuhn et le défi représenté par la polysémie des textes réflexifs de cette époque (notamment ceux de P. George), m’ont amené à échafauder une interprétation socio-linguistique (adossée à des réflexions sur lexique et significations) des changements de paradigme, qui essaie de rendre concrète l’idée kuhnienne de “ renversement gestalltique ”. Le travail qui en a résulté, inimaginable jusqu’à l’automne 2001, a pris des proportions non négligeables (en termes de numérisation de textes, de réflexions nouvelles, de place dans la thèse). Au lieu des deux parties un peu binaires projetées initialement, le texte final en comporte trois.
En avril 2003, au sortir de nouveaux problèmes de santé, j’ai entamé la phase ultime de rédaction, qui m’a donné enfin l’occasion d’écrire sur la géographie des années 1970. Confronté à un très vif débat historiographique sur la question des discontinuités épistémologiques en géographie, j’ai essayé d’argumenter de la manière la plus détaillée possible l’hypothèse d’une rupture majeure et complexe survenue par paliers dans les années 1972-1986. Pour autant, le travail de la seule archive écrite n’a cessé de me poser question : pour aborder les bouleversements de cette période, examiner leur lien avec les événements antérieurs de mai-1968, expliciter certaines frustrations exprimées par les jeunes générations d’alors, le matériau utilisé, quoique éclairant, semble appeler des compléments méthodologiques. Réaliser des entretiens auprès des acteurs de l’époque, afin de croiser enquête orale et travail du texte, est devenu l’une de mes ambitions.
Il y a plus de deux ans, le 5 décembre 2003, j’ai pu enfin soutenir ma thèse de doctorat, honorant par là le contrat tacite qui m’engageait auprès de la section 39 du CNRS. L’achèvement de ma thèse étant désormais un acquis, ma directrice et moi sommes entrés dans un processus de réflexion et de prospection pour trouver un lieu de publication. Bien entendu, ceci impliquera une réécriture, pour laquelle je compte fusionner certains chapitres et intégrer des développements nouveaux (notamment sur les formes de “ néo-réalisme ” qui ont émergé depuis les années 1980, parfois en réaction contre le nominalisme). Au demeurant, la commande faite à E.H.GO d’un petit ouvrage sur la géographie française (par l’Association pour la diffusion de la pensée française (ADPF) — qui dépend du ministère des Affaires étrangères) m’a déjà donné l’occasion de remettre mon travail de thèse sur le métier. En effet, j’ai rédigé le troisième chapitre, qui est consacré aux épistémologies de la géographie française au xxe siècle. Cela m’a permis de préciser quelques distinctions peu explicitées auparavant (sur la spécificité du réalisme géographique et ses aspects non positivistes, etc.) et de prolonger mon travail historiographique jusqu’à la période actuelle.
Durant le premier semestre 2004, j’ai soumis le texte de ma thèse à plusieurs des auteurs concernés (Franck Auriac, Claude Raffestin, Roger Brunet, Henri Chamussy). Si les réactions ont été il me semble très favorables, j’aimerais approfondir le dialogue. J’ai aussi profité de ma liberté nouvelle pour me rendre pour la première fois à un Géopoint. J’ai pu commencer à y recueillir nombre de souvenirs des fondateurs du Groupe Dupont. J’ai depuis été élu membre du groupe à l’été 2005 et les Dupont m’ont invité à venir leur parler de ma lecture des évolutions récentes de la géographie en France, ce qui a donné lieu à un exposé de presque trois heures le 9 décembre 2005, suivi d’une longue discussion.
Sur un autre plan, le thème proposé pour le colloque Géopoint 2004, la forme en géographie, m’a suggéré un réemploi de certaines réflexions que je n’avais pas voulu développer dans ma thèse. J’en ai tiré une contribution qui essaie de sortir des schèmes épistémologiques traditionnels (mais aussi du cadre discontinuiste de mes recherches antérieures) et de montrer, dans une conceptualisation proche de celle de Jean-Claude Passeron, que l’une des opérations les plus usitées en géographie serait la clinique, opération visant à identifier des cas en combinant des références universelles, une attention à la particularité et une indispensable (mais souvent peu consciente) interprétation. Parmi les diverses sortes de clinique envisageables, la géographie a pour particularité d’affectionner celles qui recourent à des répertoires de formes standardisées, parfois considérées comme des “ structures ”. Par exemple, la géomorphologie, la géographie agraire ou les recherches sur l’habitat rural, mais aussi la chorématique, voire certains essais d’application de “ modèles ”, ressortissent, pour partie au moins, à une clinique par les formes. Précocement, elles se sont adossées à des catalogues iconographiques raisonnés, qui étaient loin de n’avoir qu’une finalité pédagogique. Dans cet article bientôt publié, j’essaie d’expliciter cette idée, avant de montrer que la démarche ainsi définie n’est pas sans poser de sérieux problèmes épistémologiques.
Enfin, j’ai participé ces derniers mois à diverses entreprises collectives fédérées par l’UMR Géographie-Cités : d’une part un cours d’agrégation pour le CNED (cf. supra) portant sur la nouvelle question d’épistémologie, “ Échelles et temporalités en géographie ” ; d’autre part la rédaction d’une brochure sur la géographie française, à destination des institutions françaises à l’étranger, dont la parution est imminente. Le premier texte consiste en une réflexion sur l’évolution des significations de la notion d’échelle dans la géographie française, à partir d’un corpus restreint examiné suivant une méthodologie dérivée de ma thèse, quand bien même je n’avais jusqu’à présent pas ou peu réfléchi sur cette thématique particulière.